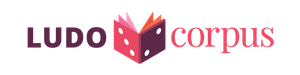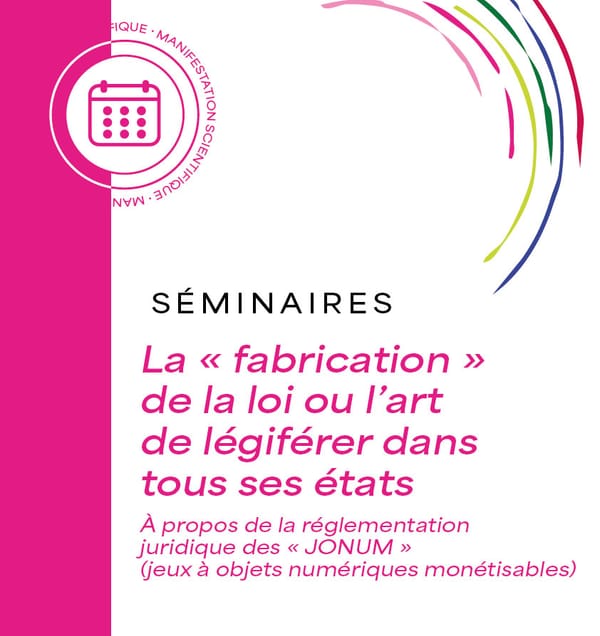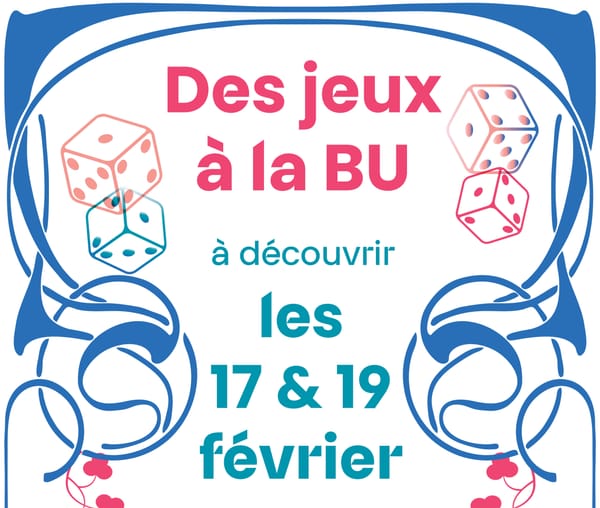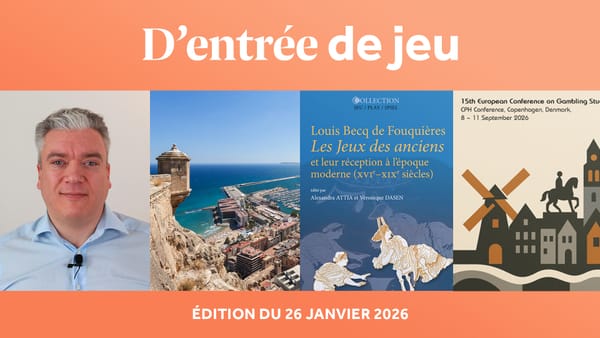Dominique Desjeux est anthropologue et professeur émérite à l’université Paris Cité, Sorbonne SHS - Laboratoire CEPED IRD et membre du Conseil Scientifique du GIS Jeu et Sociétés.
A l'automne 2024, il a fait paraître un article dans l'ouvrage collectif Vieillesse et politiques publiques, Aspects cliniques, éthiques, légaux et sociaux (éditions Dalloz, automne 2024). Il nous livre son article ainsi qu'une vidéo de présentation.
En juin 2021 je suis invité au premier colloque sur « La recherche participative au service de la santé de demain » à Tours, co-organisé par Jean Philippe Fouquet du Usetech’Lab. Leur objectif est de mieux comprendre « les enjeux sociaux et sociétaux de l’intelligence artificielle et des outils numériques sur le champ de la santé. » Leur approche est pluridisciplinaire. À cette occasion, je découvre la Tovertafel, la « table magique » en néerlandais. Elle était présentée par Dimitri Delacroix de la société MJ Innov de Saint-Étienne (1) [i].
Quelques leçons à tirer de l’histoire de la diffusion de la table magique ou l’importance des effets de réseaux sociaux « prénumériques » et numériques dans le processus d’adoption de la nouvelle pratique
Cette table magique à toute une histoire. Elle a vu le jour en Hollande entre 2015 et 2017 dans le cadre d’une recherche doctorale de l’université technologique de Delphes, aux Pays-Bas, réalisée par Hester Andersien Le Riche. Cette thèse a été co-réalisée avec la société Monobanda Digital, une société qui développe des serious games, des jeux éducatifs numériques. C’est une recherche-action sur la stimulation des personnes atteintes de « démence sévère afin de diminuer leur passivité », et notamment pour les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer. Entre-temps, Hester Le Riche a créé sa propre société. Aujourd’hui, il y aurait 3000 établissements dans le monde qui auraient adopté la Tovertafel.
A Tours, la table qui servait d’écran était couverte de très beaux poissons qui se mouvaient lentement dans un aquarium. L’illusion était parfaite. Les poissons étaient projetés à partir d’un appareil fixé au plafond, un peu comme un rétroprojecteur. J’ai eu alors l’idée de la faire expérimenter au foyer d’hébergement de la Possonière, de l’association Kypseli dans le Maine-et-Loire et affiliée à l’UNAPEI, dirigé par Éric Poirault. Ce foyer accueille des personnes avec un trouble du développement intellectuel encore au travail et d’autres qui sont à la retraite. Ma fille aînée de 52 ans qui est trisomique y séjourne entre travail à mi-temps, temps de repos et activités occupationnelles, dont des activités de stimulations organisées notamment par un éducateur, Marc Nicosia. Un autre moment fort dans la vie de ma fille est également le temps qu’elle passe en dehors de son foyer, avec ses parents ou ses frères, environs 2 à 3 mois dans l’année. Il participe notamment de sa stimulation cognitive sous des formes très variées selon le membre de la famille avec qui elle est.
Ce raccourci historique est là pour rappeler que la diffusion d’une invention ne va pas de soi et qu’elle ne se fait pas toute seule (2) [ii].
Une première leçon est que la propagation d’une nouveauté passe par des réseaux sociaux numériques, mais aussi, et peut-être surtout, « prénumériques », c’est-à-dire des réseaux humains en face-à-face qui vont préconiser, ou non, l’usage de la nouvelle technologie. Comme toute invention, indépendamment de ses qualités techniques, son développement aurait pu s’arrêter dès 2018 si des réseaux de préconisations n’avaient pas émergé tout au long de son déroulement.
La deuxième leçon est que cette technologie, la Tovertafel, qui a d’abord été créée pour stimuler les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer, peut se développer et être utilisée au-delà des premières personnes visées. Le succès de la diffusion d’une innovation, ici une nouvelle technologie adaptée aux personnes qui ont des problèmes de mémoire, de sociabilité ou de gestion de leurs émotions, est liée à sa capacité à être utilisée, voire réinterprétée par d’autres personnes.
La troisième leçon qui fait suite à la recherche-action académique développée par Hesther Le Riche pendant son doctorat est l’importance du lien institué entre recherche et acteurs concernés par le problème à résoudre, car il permet de trouver de nouvelles technologies particulièrement adaptées aux problèmes de chacun.
L’expérimentation au foyer de la Possonière
L’objectif de la recherche qualitative que j’ai réalisée en Maine-et-Loire à la Possonière est de comprendre comment se diffuse une nouveauté, la table magique, dans un foyer de personnes âgées handicapées.
L’observation des pratiques et de l’appropriation de la nouvelle technologie relève d’une classique méthode anthropologique inductive. Elle est nouvelle du point de vue des usagers et donc de la réception du nouvel objet. Je n’ai donc pas vraiment d’hypothèses. Au point de départ je ne sais pas comment se pose problème. L’important est d’explorer les usages de la table magique. Je vais donc faire cinq observations filmées, depuis la présentation de la table magique par Renaud Gaboriau (MJ INNOC) jusqu’à son utilisation par les personnes en situation de handicap. À la fin j’interviewerai 4 animateurs pour recueillir leur propre analyse.
Chaque animation dure entre 30 et 45 minutes. Elle tient compte de la capacité d’attention des différentes personnes. Grâce à la qualité des différents jeux et de l’effet écran, leur attention est très forte, même si on peut observer un peu de fatigue, pour certains, vers la fin de la séance (cf. la vidéo).
La table magique permet la stimulation grâce à une sorte de projecteur qui propose une trentaine de jeux de stimulation. Son usage est conforme aux étapes des techniques d’animation avec un départ calme, suivie par des jeux plus stimulants comme le football, puis un retour au calme. Chaque séance suit de fait une progression avec en ouverture un jeu tranquille, comme celui des poissons qu’il faut attraper avec une assiette ou celui d’une fleur qu’il faut faire grandir grâce aux mouvements de la main. Le grand intérêt de ces jeux est qu’ils ne demandent pas de force physique. Ils sont donc très accessibles. Ensuite, il est possible de jouer avec des petits chiens qui vont chercher la balle qu’on leur lance ou bien un jeu de football qui est apprécié des personnes plus compétitives. Il est aussi possible de jouer à des jeux de Kim pour stimuler la mémoire. En fin de séance, on revient à des jeux plus doux à base de musique et de couleurs.
La multiplication des supports permet de faire varier les stimuli sensibles et cognitifs et donc de maintenir l’intérêt et l’attention. Il s’adapte aux capacités de chacun sans chercher l’impossible. En effet, les capacités de jeu de chaque personne varient en fonction de leur degré d’autonomie, de leurs capacités de verbalisation ou de compréhension(3) (4) [iii]. Ce degré va en diminuant avec l’âge à l’inverse des enseignants qui travaillent avec des jeunes en progression potentielle, ce qui ne va pas de soi en termes de vie professionnelle. La facilité d’usage, comme le jeu des fleurs ou des poissons, compense en partie la perte d’autonomie. Chaque jeu est l’occasion de commentaires de la part de l’animateur afin de permettre à chacun d’améliorer ses relations avec les autres ou d’apprendre quelque chose de nouveau.
Plus généralement, la table magique permet de rappeler l’importance de la stimulation par le jeu tout au long du cycle de vie : La stimulation pour éveiller les bébés et les enfants ; les risques d’addiction à l’adolescence et la jeunesse du fait d’une stimulation trop forte et qui plus est « sans substance », comme avec les jeux vidéo ou le téléphone mobile ; les « serious games » dans la vie adulte professionnelle comme dans la pratique des jeux de formation aux diagnostics médicaux ; la stimulation des personnes âgées pour les garder en bonne santé mentale et physique ou ralentir les effets de maladie comme la maladie d’Alzheimer. Tout se passe comme si les sociétés étaient pour une part organisées autour de l’activation permanente de la stimulation, d’un côté, et de son opposé à la limitation de l’addiction, de l’autre, comme si on appuyait en même temps sur l’accélérateur et sur le frein. Belle injonction paradoxale pour les « aides humaines » !
Un détour méthodologique par l’anthropologie stratégique sur l’importance des contraintes pour comprendre les changements des « acteurs sociaux ».
L’approche anthropologique que j’ai mobilisée est empirique, inductive et compréhensive (5).[iv]. Elle n’est pas normative. Je ne dis pas ce qu’est une bonne personne en situation de handicap ou un bon éducateur. Je ne pars pas de théorie abstraite pour vérifier des hypothèses, ce qui sera indispensable dans d’autres approches. J’explore par observation de ce qui arrive dans le champ des pratiques. J’essaye de montrer les personnes handicapées en situation, pendant les loisirs. Bien évidemment, l’approche anthropologique n’est ni la seule ni la meilleure.
L’anthropologie stratégique ou le raisonnement sous contrainte de l’analyse des comportements humains est un outil qui est surtout pertinent quand on cherche à explorer ce qui émerge, ce qui est inconnu, grâce à la pratique du détour. C’est une méthode qualitative basée sur l’observation et la description des pratiques, des objets, des lieux physiques et des interactions sociales. De façon plus générale que dans le cas de l’observation de la table magique, un des grands constats de ces observations est qu’il existe un écart entre ce que disent ou pensent les personnes et ce qu’ils font en pratique. L’anthropologie stratégique explique cet écart par les contraintes matérielles, sociales et symboliques qui transforment les intentions en action et en pratiques différentes.
Le concept de contraintes est ambivalent puisqu’il peut autant renvoyer à l’idée de frein que de pression pour change. On peut les ramener à une dizaine de grandes contraintes matérielles, sociales et symboliques qui organisent la diffusion des innovations et les changements de comportement, mais leur chiffre n’est pas limité.
Il y 5 contraintes matérielles, dont le temps à partir, par exemple, d’une question : le changement proposé fait-il gagner ou perdre du temps ? S’il en fait perdre, l’innovation aura plus de mal à se diffuser. Pour l’espace, je me demande s’il y a la place physique de faire le changement ; pour le budget, est-ce que le changement est supportable financièrement. Je cherche à décrire le système d’objets concrets nécessaire à l’usage du nouvel objet ou service pour voir ce qui manque et donc ce qui pourrait empêcher sa diffusion. Aujourd’hui, je regarde beaucoup les risques que provoqueraient une panne d’énergie électrique ou encore quelle est « l’énergie humaine » disponible et comment se réalise la division sexuelle et sociale des tâches.
J’ai repéré 3 grandes contraintes sociales. La première est la contrainte d’apprentissage. Elle interroge la complexité du processus d’acquisition. S’il est complexe, il sera plutôt un frein. Il peut cependant disparaitre sous forte contrainte de survie ou de budget. La deuxième est la norme de groupe. Elle définit ce qui est prescrit, permis, interdit plus ou moins implicitement de faire dans un groupe professionnel ou autre. La troisième est celle des réseaux sociaux « prénumériques » et numériques comme base du jeu des acteurs qui produisent les normes en faveur ou défaveur de l’innovation, comme je l’ai évoqué pour la table magique. Il n’existe pas de sociétés sans réseaux sociaux alors que paradoxalement le terme de réseau a souvent une mauvaise image. Il est associé au piston et aux groupes de pression, comme si une société, et je travaille autant en Chine, qu’aux États-Unis, au Brésil ou en Afrique, pouvait fonctionner sans jeu d’acteurs et donc sans pression. C’est pourquoi je pense que d’un point de vue socioanthropologique, nous ne sommes pas dans des sociétés individualistes, sauf en valeur, mais pas en pratique, car sinon il n’y aurait plus de société.
Il existe enfin 3 contraintes symboliques et psychosociales. La charge mentale, concept important venu de l’ergonomie des années 1980, est une contrainte centrale. Le changement aura du mal à se faire si la nouvelle pratique augmente les inquiétudes ou les angoisses des acteurs sociaux, si son appropriation est complexe, par exemple. L’identité personnelle ou professionnelle interroge le changement pour savoir s’il va faire « baisser ou monter la face » de l’autre, 面子 Miànzi, la face, comme on dit en chinois, s’il menace l’identité masculine ou féminine ou le statut social. La dernière contrainte pose la question des risques perçus par l’introduction de la nouvelle technologie. Est-elle perçue comme menaçante pour son emploi, par exemple, ou pour sa santé.
Toutes ces contraintes, qui sont en même temps des potentialités, sont considérées comme des causes qui expliquent le jeu des acteurs en faveur ou en défaveur de l’innovation, en situation, dans un système d’action donné. Si la situation change, les contraintes changent. Dans le cas de la table magique, son apprentissage est simple, elle n’augmente pas la charge mentale, elle ouvre plutôt des opportunités de jeux nouveaux et fait « monter la face » des éducatrices et des éducateurs.
La « connaissance mobile » grâce aux échelles d’observation : un moyen de s’adapter aux changements de situation en période de crise et de travailler en mode pluridisciplinaire
En période de crise et d’incertitude, comme celle que nous vivons aujourd’hui, la « connaissance mobile » est centrale. Elle est un moyen d’échapper à nos tunnels cognitifs.
La connaissance mobile s’appuie sur une méthode, les échelles d’observation. Elles permettent de faire varier les focales « macro » ou « micro », et les angles d’observation, comme les pratiques, les contraintes, le sens, à chaque focale choisie, et donc de limiter les angles morts dans lesquels se cachent les signaux faibles. Ils sont notamment invisibles des radars quantitatifs des sondages qui n’ont pas les bonnes lunettes pour observer les jeux d’acteurs, les effets d’organisation, les systèmes logistiques et énergétiques et donc toutes les contraintes matérielles, sociales et symboliques qui sous-tendent les processus d’innovation. Ces jeux sont aussi invisibles des recherches expérimentales de laboratoire. Ne pas voir n’est pas une critique. Personne ne peut tout voir, d’où l’importance de la mobilité pour explorer l’invisible. Les approches qualitatives ont-elles même de nombreux angles morts qui sont ceux des connaissances apportées par les approches quantitatives et expérimentales.
La connaissance mobile permet d’apprendre à croiser la diversité des explications scientifiques entre l’effet de corrélation (indicateur de la causalité), de situation (système d’action) et de sens (qui met en mouvement l’énergie humaine) dont la pertinence varie en fonction des problèmes et des situations ainsi que des différents métiers, professions et disciplines.
L’échelle d’observation est un outil de travail pluridisciplinaire qui permet de faire collaborer des métiers qui ont des modèles d’explication différents. Une focale n’est pas meilleure en soi.
La rigueur des approches qualitatives inductives
Pour réussir, il faut juste se rappeler que la rigueur des approches qualitatives ne va pas de soi. Elle a ses propres critères de scientificité que l’on peut ramener à six. Le premier est l’induction, qui a souvent mauvaise presse. Elle est la méthode qui permet d’explorer la réalité sans faire d’hypothèses autre que méthodologique. Je présuppose juste, comme je l’ai montré ci-dessus, qu’il existe des contraintes matérielles, sociales et symboliques qui influent sur les comportements des acteurs, ainsi que des effets de cycles de vie ou de division genrée des tâches. De plus, les prises de décision sont considérées comme relevant d’un processus collectif dans le temps et comme la résultante d’interactions sociales, au moins à notre échelle d’observation mesosociale et microsociale. Le deuxième est l’ambivalence, qui postule que toute réalité comprend une face négative et une face positive et qu’elles sont indissociables, comme le yīn 阴 « féminin » et le yáng 阳 « masculin ». Le troisième, souvent le plus difficile à comprendre, est la généralisation de la « diversité des usages ou des pratiques » en fonction de leur occurrence, tout en évitant toute interprétation en termes de fréquence et de pourcentage, ce qui n’aurait pas de sens sur des échantillons aussi faibles que celui de la table magique et de la plupart des enquêtes qualitatives. Le quatrième est l’approche compréhensive, qui essaye d’éviter les jugements de valeur ou les dénonciations. Le point de vue des acteurs est le point de départ de la compréhension de leurs pratiques et du sens qu’ils leur donnent, pour faire apparaître des logiques sociales sous-jacentes, des enjeux au-delà de leurs seules perceptions ou de leurs vécus. Le cinquième est un principe de symétrie par rapport à l’efficacité ou l’inefficacité d’une action : la réussite d’une action va dépendre dans tous les cas des contraintes du jeu social dans lequel elle est encastrée. Le sixième est que nous ne postulons pas qu’une fréquence quantitative serait plus vraie que la diversité des occurrences qualitative, mais qu’elle nous apprend autre chose. Les approches qualitatives sont particulièrement pertinentes pour faire ressortir les mécanismes humains qui sont mobilisés tout au long des processus d’innovation. La connaissance de ces mécanismes explique pourquoi une nouveauté est adoptée ou non, au-delà de ses qualités médicales ou techniques.
Le constat plus général est qu’il n’est plus possible de trouver une solution méthodologique unique à tous les problèmes qui émergent de partout. Cela demande de croiser des informations produites par des méthodes quantitatives et qualitatives, des approches macrosociales et microsociales, individuelles et collectives. Il faut donc de plus en plus une connaissance mobile qui fait varier la focale des échelles d’observation et donc les approches pluridisciplinaires.
Dans ces conditions, une observation qualitative est tout à fait généralisable si on ne limite pas le vrai au chiffre, et si on ne réduit pas la société à l’observation des individus et de leurs motivations ou au biologique.
Conclusion
Le plus visible est le plaisir que la plupart des participants prennent à jouer et à se retrouver ensemble autour de la table. Le jeu représente un détour par rapport aux contraintes de la vie quotidienne, ou une parenthèse, pour atteindre des moments heureux. Il vient s’intercaler aux différents temps de vie de la personne et vient compléter d’autres dynamiques personnelles, relationnelles et cognitives comme la vie au travail, le quotidien avec les autres résidents, les périodes dans la famille et les moments de solitude.
Tout au long de l’observation, j’ai assisté à des moments émouvants de rire, de plaisir d’avoir réussi ou de moments magiques à écouter un des membres du groupe chanter une chanson de Renaud. Chacun est encouragé à réussir tout en évitant toute situation de mise en échec.
Un des résultats inattendus de l’enquête est qu’en discutant avec les animateurs, j’ai découvert que la tovertafel avait favorisé une réflexion sur la pratique du métier d’aide aux personnes vieillissantes en situation de handicap. Une de leur conclusion est que l’important n’est peut-être pas de favoriser l’acquisition d’une nouvelle compétence liée à la mémoire notamment, mais plutôt de donner envie, de faire plaisir, de donner des moments de joie, de retrouver le bonheur de vivre ensemble.
Dominique Desjeux, anthropologue
Professeur émérite à l’université Paris Cité, Sorbonne SHS
Laboratoire CEPED IRD
Le 5 juin 2024
[i] Une première version courte de cet article a été publié dans Hors-Série ASH n° 32 — Août 2023 - 44 pages https://boutique.ash.tm.fr/achat-au-numero/horsseries-ash/jeux-et-maladie-dalzheimer (1)
[ii] Cf Dominique Desjeux sur la réception des innovations (2)
[iii] Plus généralement, sur les approches capacitaires du handicap qui se différencient de l’angle des approches biologiques, sans bien sur les nier, voir : (3) et (4)
[iv] Cf. Dominique Desjeux sur la méthode inductive (5)
Bibliographie
[1] https://boutique.ash.tm.fr/achat-au-numero/horsseries-ash/jeux-et-maladie-dalzheimer Hors-Série ASH n° 32 — Août 2023 - 44 pages
[2] Desjeux Dominique (éd.) (2023), Sur la réception des innovations, PUF
[3] Myriam Winance (2024), Les approches sociales du handicap. Une recherche politique, Presses des Mines, 2024
[4] Desjeux Cyril (2024), Le handicap au pouvoir, PUG.
[5] Desjeux Dominique (2018), L’empreinte anthropologique du monde. Méthode inductive illustrée, Peter Lang (en libre accès en ligne : https://www.calameo.com/read/003221622dd31177099ba)