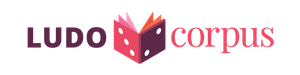Si la chance en français, venue du latin cadere « tomber », est étymologiquement rythmique, cadence et échéance, ce « qui tombe à pic » ou « ce qui tombe dessus », l’anglais Luck et l’allemand Glück qui lui est apparenté, viendraient quant à eux du néerlandais geluk, le « bonheur », et de l’ancien français glic, qui a deux significations : « jeu de carte », ou bien « hasard ».
Le hasard quant à lui vient de l’arabe al-zahr: « dé », « jeu de dé ». Cela est connu. L’on sait peut-être moins cette jolie chose que le jeu de dé s’appelle al-zahr parce que sur la face gagnante du petit cube se trouvait dessinée une fleur, zahr, en arabe. La chance est une fleur.
Les Grecs de l’Antiquité, quant à eux, craignaient qu’une punition divine ne tombe sur ceux qui se croyaient trop chanceux. Nul ne devait se vanter de sa bonne fortune ou négliger de l’attribuer aux dieux, par crainte que ne se déchaîne Némésis, la Vengeance. Leur chance, la Tuchê, comme la chance française, tombe et rebondit comme une balle, se jouant des cités et des états auxquels elle semble avoir été attachée plus qu’aux personnes. Son homologue romaine est Fortuna, la déesse de la chance, dont le nom dérive du verbe latin ferre, « porter » et évoque le sort, ou la fertilité, dont la Fortune serait porteuse.
Lier la maîtrise de la fertilité et le sort, de nombreux peuples de l’Antiquité le faisaient, dans la pratique de l’exposition, qui condamnait les nouveau-nés à la mort, mais non sans leur laisser une chance de survie. Pas tous les peuples, cependant, et ni les égyptiens ni les juifs n’approuvaient cet abandon. Lorsqu’un malchanceux enfant venait au monde, handicapé, laid, illégitime, surnuméraire ou plus simplement fille, on l’exposait, l’abandonnant à la nature, comme cet Œdipe dont le nom signifie « pieds enflés », attaché à un arbre sur le Mont Cithéron[1]. Si, comme Œdipe, l’enfant avait la chance de survivre, ou si au contraire il mourrait, alors c’est qu’il devait en être ainsi. Le petit mort avait bien été porteur d’une faute ou d’un mal ; le petit survivant était bien destiné à un grand destin, le plus souvent celui d’un fondateur. Le psychanalyste Otto Rank a montré que l’exposition et l’adoption par un couple « inférieur » au couple de géniteurs, souvent des serviteurs, voire des animaux, sont constitutives des récits héroïques[2]. Le héros est avant tout celui qui a eu de la chance.
Ce mode de pensée, par lequel la chance de l’homme est liée à un destin antérieur à ses actions, existe dans plusieurs religions : on y reconnaît la roue des réincarnations de l’hindouisme, la baraka musulmane, la Grâce protestante. La chance devient alors la rétribution d’une vie passée, le signe d’une l’élection, celui de la grâce de Dieu. Lorsqu’un bâtiment non assuré brûle dans Les Revenants d’Ibsen[3], est-ce un effet de la malchance ou de la Providence ? Providentia, la « prévoyance », est liée à la bonne économie, mais surtout, pro-videre, à ce qui se voit avant, à ce qui se voit tout simplement.
Une chance qui donne à voir la vérité de l’être, une chance signe du jugement favorable de Dieu : de cette logique procède l’ordalie, dont on trouve déjà la trace dans le code d'Hammourabi, pratique courante dans l’Europe médiévale.
Dans l’ordalie unilatérale, un accusé doit prouver son innocence, par une épreuve qui le confronte aux éléments naturels. Il peut le faire en portant une barre de fer rougie ou en marchant sur elle. Sa main ou son pied sont ensuite bandés, puis examinés. Si la plaie est bien cicatrisée après trois jours, l’accusé est reconnu innocent, d’où l’expression : « mettre sa main au feu ». L'ordalie par l'eau froide est souvent réservée aux sorcières. Dans l'ordalie bilatérale, deux plaignants s’affrontent en duel. Ou encore, les plaignants doivent se tenir les bras levés. Le premier à baisser les bras avait tort, il avait « baissé les bras ».
Dans une analyse non religieuse de l’ordalie, on peut identifier la chance à une physiologie, et la situer du côté du plus fort. Les chanceux sont innocents. Et les malchanceux coupables.

Plus tard dans le Moyen Âge, comme encore à l’époque élisabéthaine, on se représente la chance sous la forme d’une roue de la Fortune, de la Fortuna latine, un jour en haut, un jour en bas. La chance retrouve alors son sens étymologique de retour et de retournement : ainsi de la fortune des navires en mer, qui se retournent et font naufrage, ou s’en retournent à bon port.
Dans Le Marchand de Venise de Shakespeare[4], pièce de la fin du XVIe, l’enjeu du pari sur la bonne fortune d’un navire marchand est une livre de chair réclamée par le prêteur Shylock, à la fois rien, et tout, parce qu’une part de soi-même. Celui qui prend ce risque dérisoire et exorbitant s’appelle Antonio. De manière intéressante, il s’agit d’un personnage mélancolique. Antonio malchanceux ne peut faire face à l’échéance et Shylock, humilié par le traitement imposé aux Juifs à Venise, exige son dû. Mais que diable Antonio allait-il faire dans cette galère ?
L’expression vient de la célèbre réplique des Fourberies de Scapin, de Molière[5]. La galère turque imaginaire dont il est question coûtera cher au barbon. Car dans Le Marchand de Venise comme dans Les Fourberies de Scapin, les enjeux de la chance sont d’abord économiques. Mais dans les deux pièces, cette chance économique se confond avec la bienveillance et le bon sens, se provoque par l’habileté, et s’incarne en une femme amoureuse, Portia, et un valet dévoué, Scapin, tous deux « maîtres du jeu ».

L’enjeu de la chance s’avère économique également dans Le Joueur de Dostoïevski, dont le héros, un jeune noble russe séjournant dans une ville d’eau, choisit de miser sur sa chance plutôt que dans l’économie ou le placement :
Cinquante ans peut-être, ou soixante-dix ans plus tard, le petit-fils du premier Vater dispose déjà d’un capital respectable qu’il transmet à son fils, son fils au sien, celui-ci à son fils, ce dernier au sien et, au bout de cinq ou six générations, il en sort le baron Rothschild en personne… Eh bien, Monsieur, n’est-ce pas là un spectacle grandiose ; ce labeur, poursuivi durant cent ou deux-cents ans avec patience, intelligence, honnêteté, force d’âme, fermeté, prudence, et la cigogne sur le toit ! … (…) Eh bien, Messieurs, je vous le dis : je préfère, en vérité, mener une vie scandaleuse à la russe ou m’enrichir à la roulette… Et je n’estime pas que mon être tout entier puisse être réduit à un simple apport nécessaire à l’augmentation d’un capital[6].

La chance, tentée à la roulette, devient pour lui « la seule issue », la « planche de salut », une manière de se soumettre à la volonté divine, de reproduire la passion du Christ, une manière d’être russe. Sans doute moins immédiatement dangereuse que la tout aussi identitaire roulette russe… mais le joueur n’en risque pas moins beaucoup.
Deviendra-t-il riche comme Crésus ? Ou comme Picsou ? Car les canards des dessins d’animation de Walt Disney se répartissent du point de vue de la chance en trois types : Donald, le malchanceux, toujours endetté, son cousin Gontrand, jouissant d’une chance jamais démentie, et Picsou, l’oncle, millionnaire dont la chance tient au travail et à son sou porte-bonheur !
Le chanceux Gontrand Bonheur a une chance insolente qui ne se partage pas, ne se transmet pas, et n’engendre rien. Mais elle le protège toujours et lui permet de jouir infiniment. Jouissance toute matérielle, qui n’évite à Gontrand ni les échecs amoureux ni une forme de solitude.
A l’inverse, Donald, qui n’a jamais de chance, ni d’argent, est aimé de Daisy et de ses trois neveux, Riri, Fifi et Loulou.
L’oncle Balthazar Picsou (en anglais Scrooge McDuck) a la chance qu’il se donne, au prix d’un travail acharné et d’une vigilance permanente. Avaricieux, il tient son nom du Scrooge de Charles Dickens dans Un chant de Noël[7]. Quant au « Mc » de son patronyme, il évoque des origines écossaises et tous les clichés qui les accompagnent.
Picsou a amassé une énorme fortune entassée dans un coffre-fort. Mais parmi les montagnes d'argent qui y sont accumulées et sur lesquelles il campe, une pièce joue un rôle à part, son premier sou gagné, son « sou-fétiche », dont il reconnaît le son entre tous. Il s'agirait d'un dime de 1875 - gagné en cirant les chaussures à Glasgow, en Ecosse où une dime américaine ne vaut pas grand-chose. Mais la pièce viendrait en fait du père de Picsou, qui l’aurait donnée à un inconnu pour que son fils la gagne en lui cirant les chaussures, lui transmettant ainsi à son insu le goût du travail et un projet d’émigration aux Etats-Unis.
La chance serait-elle finalement un message familial transmis à notre insu ?
Je trouve pour ma part sans cesse des trèfles à quatre feuilles. Deux pensées me viennent à ce propos depuis mon enfance : je ne serai, grâce aux trèfles à quatre feuilles, jamais sans ressources. Car je m’imagine qu’en cas de difficulté, je pourrais faire sécher soigneusement les trèfles à quatre feuilles trouvés, les encadrer joliment, et les vendre, pour quatre sous, à ceux qui y voient un signe de chance et à qui ils en porteraient donc un peu. Ma seconde pensée est que je vois les trèfles à quatre feuilles là où les autres ne le font pas parce que j’ai trois sœurs, et que nous sommes donc quatre filles. Manifestement, je me représente cette fratrie comme une vraie chance dans ma vie personnelle.
Juliette Vion-Dury, Professeure de littérature générale et comparée de l’Université Sorbonne Paris Nord. Membre du laboratoire IRIS (UMR 8156)
Sophocle, Œdipe Roi, traduit du grec par Sophocle, Tome II. Ajax, Œdipe Roi, Électre, texte établi par Alphonse Dain, traduction de Paul Mazon, Les Belles Lettres, « Collection des universités de France », 1989 (première édition 1958). ↩︎
Otto Rank, Le Mythe de la naissance du héros. Essai d'une interprétation psychanalytique du mythe (1909), suivi de La légende de Lohengrin, Paris, Payot, 2000. ↩︎
Henrik Ibsen, Théâtre, Paris, 2006, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, no 529. ↩︎
William Shakespeare, Le Marchand de Venise, trad. de l'anglais par François Laroque, Paris, Librairie Générale Française, coll. « Livre de Poche / Théâtre de poche », 2008. ↩︎
Molière, Les Fourberies de Scapin, in Georges Forestier (dir.), Théâtre complet de Molière. Tome II, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2010. ↩︎
Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski, Le Joueur (1866), traduit du russe par Joëlle Roche-Parfenov avec la collaboration de Michel Parfenov, Paris, GF Flammarion, 2013, p. 68-71. ↩︎
Charles Dickens, A Christmas Carol and other Christmas Books, Oxford: Oxford University Press, 2006. ↩︎
Crédit image :
Photo de Dustin Humes sur Unsplash